Biodiv'Cevennes, l'atlas de la flore et de la faune du Parc national des Cévennes
Depuis sa création en 1970, le Parc national des Cévennes contribue à la
connaissance des patrimoines naturels. Ces derniers constituent une
biodiversité particulièrement riche fortement liée aux activités
humaines et à une grande diversité climatique et paysagère.
L’établissement public porte une responsabilité importante dans
l'acquisition et la diffusion de cette connaissance. Cet atlas vous
présente des observations réalisées dans le cadre de différents
protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni
d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

Fiches espèces
Retrouvez la fiche de chaque espèce avec leur carte des observations, leur répartition altitudinale et mensuelle, ainsi que des descriptions, photos, vidéos, audios et liens complémentaires

Fiches communes
Découvrez les espèces observées sur chaque commune du parc national et affichez leurs observations sur la carte de la commune.

Galerie photos
Découvrez les photographies des différentes espèces, réalisées principalement par les agents du Parc national lors de leurs missions sur le terrain.

Faune
Une biodiversité pléthorique !
La faune du Parc national est extrêmement diversifiée. Plus de 2 400
espèces ont été répertoriées. On y trouve des espèces aussi bien
méditerranéennes que continentales ou alpines ; forestières, steppiques,
rupestres ou liées aux milieux humides.
La richesse de la faune du Parc national est caractérisée par la
présence de 70 espèces de mammifères (sur 135 en France), 195 espèces
d’oiseaux (dont 135 nicheuses), 16 espèces d’amphibiens, 15 espèces de
reptiles, 23 espèces de poissons et plus de 2 000 espèces d’invertébrés
(dont 1 824 d’insectes).
Des animaux d’une grande valeur patrimoniale
En se fondant sur la nomenclature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), on dénombre 42 espèces strictement menacées (dont 11 en danger et 31 vulnérables), 18 espèces rares, 14 espèces au statut indéterminé, et 20 espèces à surveiller. Le Parc national abrite aussi des espèces d’intérêt communautaire. 103 sont concernées par la directive européenne « Habitats » - dont 2 sont des espèces prioritaires, la rosalie alpine et l’osmoderme érémite – et 48 par la directive « Oiseaux » - dont une prioritaire, le vautour moine. Enfin, 229 des espèces présentes sont totalement protégées par le Code de l’environnement français.Le rôle de l’homme, important mais contrasté
L’homme a constitué un facteur direct de disparition pour les espèces de grande taille. Pratiquement tous les grands mammifères, ongulés et prédateurs, et la plupart des grands rapaces et gallinacés ont disparu à l’époque historique. Il a également indirectement favorisé de nombreuses espèces par son action sur le maintien des milieux ouverts : pelouses, prairies, cultures et landes. Ses modes de production, relativement peu agressifs pour le milieu naturel jusqu’à ce jour, ont préservé les chaînes alimentaires.Des réintroductions réussies
Enfin les différentes actions de gestion en faveur de la faune et, plus récemment, les réintroductions menées avec succès par le Parc national ont permis de favoriser ou d’assurer le retour de quelques espèces disparues, comme les vautours fauve et moine.Des espèces disparaissent, d’autres s’installent
L’homme cependant ne maîtrise pas tout. On constate des évolutions divergentes selon les espèces. Avec la disparition de l’outarde canepetière et de la perdrix grise, coïncide le retour de la loutre d’Europe et de la chouette de Tengmalm, pour ne citer que ces quelques exemples.
« La base de données du Parc national n'est pas un inventaire. Elle
rassemble des informations collectées dans le cadre de différents
protocoles scientifiques avec des objectifs différents. De fait, le
nombre important d'observations de bouquetins ne veut pas dire qu'il
s'agit de l'espèce la plus présente dans le massif mais bien d'une
espèces très suivie, notamment dans le cadre des réintroductions ! »
Pour en savoir plus :
https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-connaissances/les-patrimoines/la-faune.

Flore sauvage
Plus de 2 250 espèces de plantes à fleurs ont été recensées dans le
Parc national, ce qui représente 40 % de la flore française, sur
seulement 0,5 % de la surface du territoire national.
Certaines plantes présentent des histoires de vie remarquables, allant
des héritières de pratiques agricoles anciennes (prairies de fauche,
cultures extensives de céréales) aux exploratrices de la haute
montagne.
Le monde des plantes sans fleurs est également très diversifié dans le Parc national : 60 espèces de fougères, environ 730 espèces de mousses, plus de 1 000 lichens et plusieurs milliers de champignons ont été découverts ces dernières années, lors d'inventaires menés par des spécialistes en partenariat avec les équipes du Parc national.
Une telle diversité d’espèces est avant tout le reflet :
Le monde des plantes sans fleurs est également très diversifié dans le Parc national : 60 espèces de fougères, environ 730 espèces de mousses, plus de 1 000 lichens et plusieurs milliers de champignons ont été découverts ces dernières années, lors d'inventaires menés par des spécialistes en partenariat avec les équipes du Parc national.
Une telle diversité d’espèces est avant tout le reflet :
- d’une grande variété de roches (schiste, granite, grès, dolomie, calcaire, marne...),
- des influences climatiques contrastées (méditerranéenne, atlantique et continentale,
- de l’amplitude altitudinale de 300 m à 1 700 m,
- et des différentes utilisations passées et actuelles de ce territoire par l’homme.
Les contrastes peuvent être saisissants : dans un rayon de 30 km
autour des montagnes du Bougès se côtoient des
landes thermophiles à bruyère arborescente, des
landes montagnardes à callune et myrtille, des
landes subalpines à callune
et
genévrier nain, des chênaies vertes à
cyclamen des Baléares
et des
hêtraies montagnardes à luzule blanc de neige.
Autour du réseau particulièrement dense de sources et de cours d'eau se développent des végétations particulières : dans les tourbières, le rossolis, plante carnivore, est fréquent au pied des buttes moussues constituées de sphaignes ; l'aconit de Napel et le doronic d'Autriche signalent de loin les berges des ruisseaux, constituant de hautes prairies fleuries, les mégaphorbiaies ; une orchidée gracieuse et rare, la spiranthe d'été, affectionne particulièrement les fissures et replats suintants au contact des berges rocheuses.
Autour du réseau particulièrement dense de sources et de cours d'eau se développent des végétations particulières : dans les tourbières, le rossolis, plante carnivore, est fréquent au pied des buttes moussues constituées de sphaignes ; l'aconit de Napel et le doronic d'Autriche signalent de loin les berges des ruisseaux, constituant de hautes prairies fleuries, les mégaphorbiaies ; une orchidée gracieuse et rare, la spiranthe d'été, affectionne particulièrement les fissures et replats suintants au contact des berges rocheuses.
En savoir plus sur la
Flore du PNC.

Une stratégie scientifique.
Pour la connaissance et la protection.
Les enjeux des années à venir pour le territoire sont importants :
changements climatiques, évolutions socio-économiques, déclin de la
biodiversité, modification des paysages liée notamment à la
fermeture des milieux, raréfaction de la ressource en eau…
L’établissement public du Parc doit donc gérer un environnement en
profonde mutation et continuer notamment d’étudier l’interaction
homme-nature, elle-même en perpétuelle évolution, fondement de son
identité et de sa richesse.
Adossée à la charte, la stratégie scientifique du Parc national
2014-2029 porte la double ambition de continuer à acquérir,
comprendre et partager la connaissance des patrimoines, et
d’anticiper et accompagner les dynamiques sociales et économiques et
les grandes mutations environnementales. Elle fixe les orientations
et les priorités opérationnelles pour quinze ans en lien avec les
huit axes de la charte. Voici, ci dessous, quelques exemples de ces
priorités.
Des espèces prioritaires
L’acquisition des connaissances sur la biodiversité porte sur des espèces qui font l’objet de démarches nationales, dans le cadre des plans nationaux d’action. Des espèces indicatrices de certains fonctionnements ou changements sont également étudiées (papillons de jour, oiseaux des milieux ouverts et forestiers, rapaces, insectes indicateurs de vieilles forêts…). Six groupes d’espèces prioritaires pour le Parc national sont identifiés dans la stratégie scientifique et font l’objet d’inventaires et de suivis : les plantes à fleurs et les fougères (ou flore vasculaire), les papillons de jour (ou rhopalocères), les libellules (ou odonates), les criquets, sauterelles et grillons (ou orthoptères), les vertébrés : oiseaux, rapaces (hors vautours), mammifères, chiroptères, poissons et écrevisses, reptiles et amphibiens), et les coléoptères inféodés au bois mort et aux déjections animales.Le suivi des paysages agropastoraux
Les paysages de l’agro-pastoralisme ont valu au territoire son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Construits au fil des siècles par l’homme et les troupeaux, ces paysages sont évolutifs et vivants. La valorisation et la conservation de ce joyau supposent de mieux connaître le patrimoine bâti agropastoral, ainsi que la dimension immatérielle et les savoir-faire qui lui sont associés.L’eau et les milieux aquatiques
L’eau et les milieux aquatiques, richesses reconnues du territoire, restent des thèmes prioritaires. L’amélioration des connaissances des fonctionnements hydrologiques des milieux caussenards et cévenols et leur partage dans le cadre d’un observatoire structureront l’engagement du Parc national et de ses partenaires.
En savoir plus sur la
strategie scientifique.

Sensibilité et diffusion des données
Les atteintes à la biodiversité et à la géodiversité résultent
généralement d'une méconnaissance de ce patrimoine et il est donc
dans l'intérêt général de communiquer largement les informations
sur sa localisation. Les données sensibles constituent une
exception. Elles sont définies par le protocole du SINP, en
référence à l’article L.124‐4 du code de l’environnement, comme
des données particulières qui ne doivent pas être largement
diffusées pour éviter de porter atteintes aux éléments qu'elles
concernent (espèce, habitat ou élément géologique).
Dans le cadre du SINP et de la Loi Lemaire (octobre 2017), le Parc
national des Cévennes est tenu de diffuser ses données
d’observation. Cette diffusion doit être réalisée sur internet
sans restriction d’accès, sauf pour les données dites sensibles.
La sensibilité des données a été définie par des groupes de
travail au niveau national et régional. Elle repose sur
l’évaluation de trois critères :
- Risque d’atteinte volontaire dans la région ou dans un même contexte
- Sensibilité intrinsèque de l'espèce
- Effet de la diffusion de l'information (La disponibilité de l’information augmente‐elle le risque ?)
Pour chaque espèce, un niveau de dégradation géographique est
définie en fonction de certains critères (zone géographique, date
de la donnée, période d’observation, autres critères) : maille 10
km par 10 km, commune, département.
Parmi les données disponibles au sein du Parc national des
Cévennes, 87 espèces sont concernées par cette dégradation, ce qui
représente moins de 2 % des données.
En savoir plus sur les espèces sensibles :
Réseaux d'observateurs.
Faisceaux de connaissances.
Le Parc national fait partie d'un réseau de collecte de données
naturalistes. Il contribue ainsi à enrichir des bases de données
thématiques mises à disposition tant des spécialistes que du
public.
En multipliant les conventions d'échanges, le Parc national
valorise et élargit l'utilisation des données acquises par ses
agents.
Selon les sites internet, il est possible de CONSULTER les
informations, de TÉLÉCHARGER des synthèses voire de PARTICIPER
aux observations.

Sur le site consacré à l'INPN (Muséum national d'histoire
naturelle), on retrouve plus de 300 000 données sur la faune du
Parc national des Écrins parmi les 30 millions collectées sur
l'ensemble du territoire national et agglomérées dans cet
inventaire national.
Le Muséum national utilise ces informations pour réaliser des synthèses aux échelles nationales et internationales.
Cette démarche permet d'inscrire les enjeux environnementaux dans les politiques nationales et européennes.
Le Muséum national utilise ces informations pour réaliser des synthèses aux échelles nationales et internationales.
Cette démarche permet d'inscrire les enjeux environnementaux dans les politiques nationales et européennes.

GeoNature-atlas.
Dans la constellation de l'opensource.
Biodiv'Cévennes utilise l'outil
GeoNature-atlas
développé par le Parc national des Écrins et publié sous
licence libre. Il est ainsi transférable librement à d'autres
structures qui souhaitent partager leurs observations
naturalistes en se basant sur les référentiels nationaux de
l'INPN.
Téléchargez la
fiche de présentation de GeoNature-atlas
pour en savoir plus.
Il fait partie d'un ensemble d'outils développé par le Parc
national et ses partenaires, pour pouvoir saisir, gérer et
traiter les données des différents protocoles (https://geonature.fr).
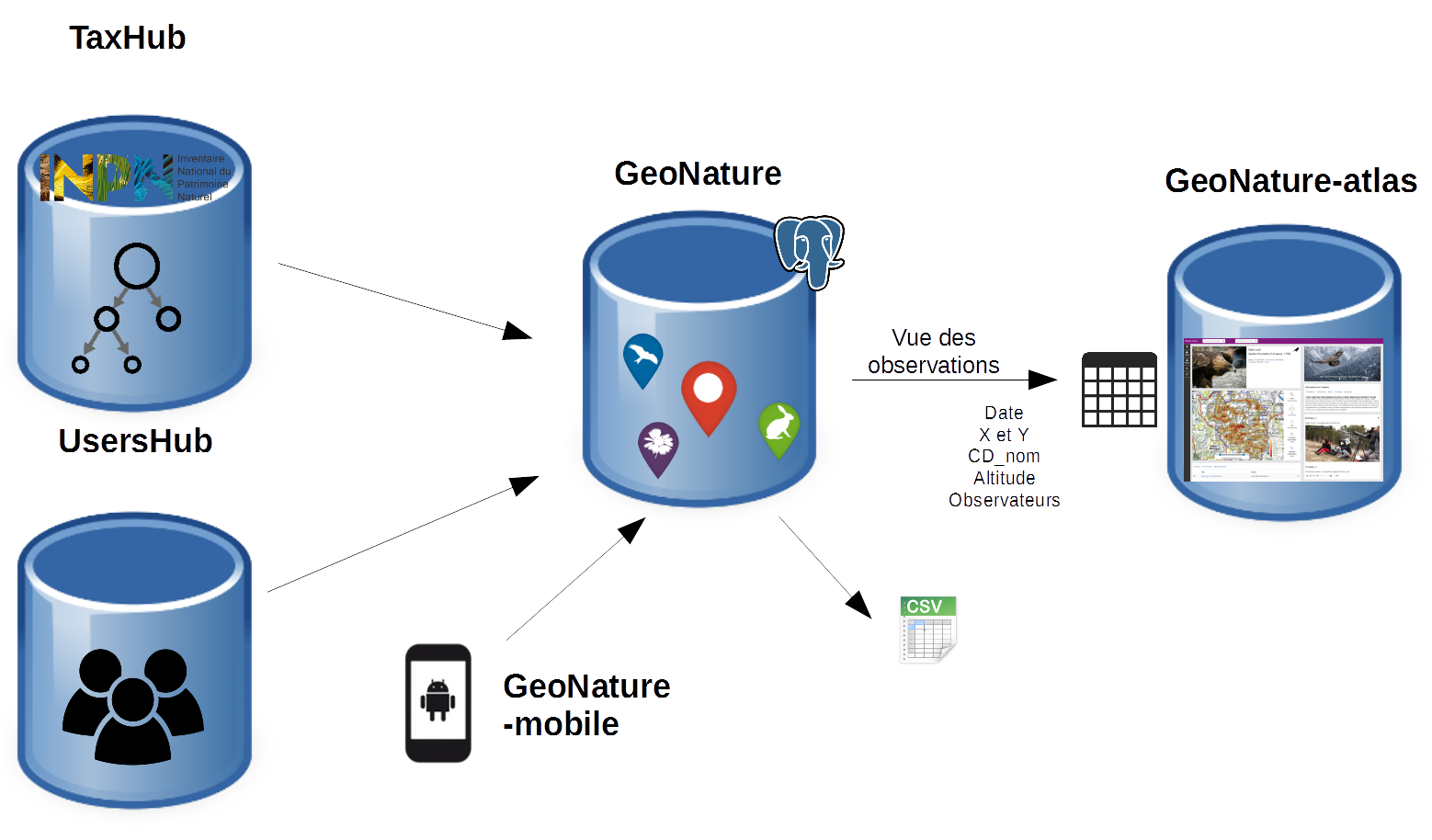
* Un logiciel Opensource est un programme informatique dont
le code source est distribué sous une licence dite « libre
», permettant à quiconque de lire, modifier ou redistribuer
ce logiciel.



